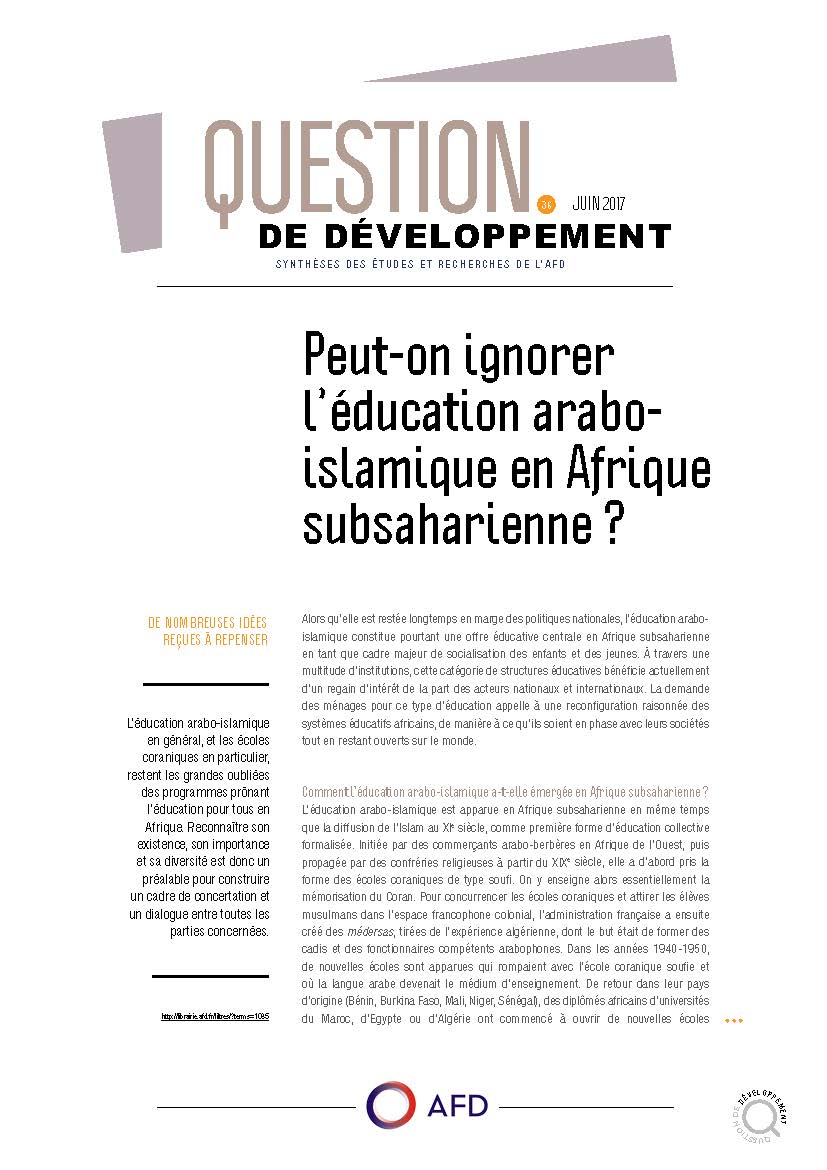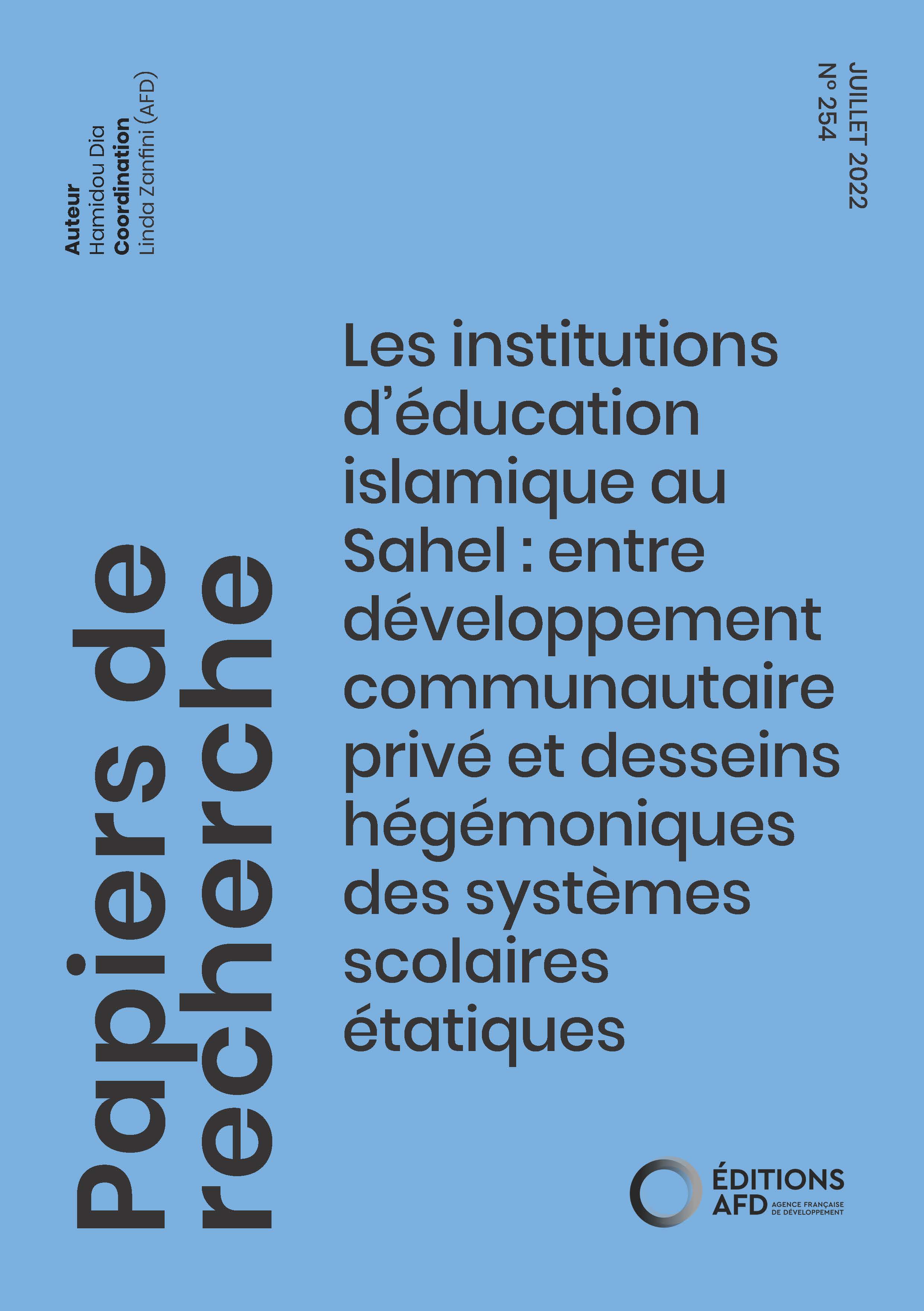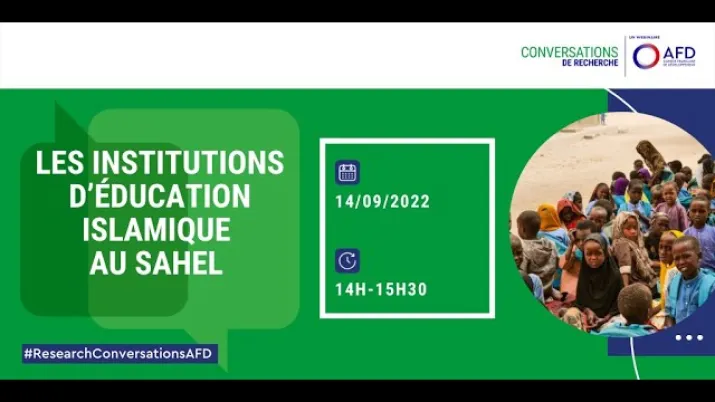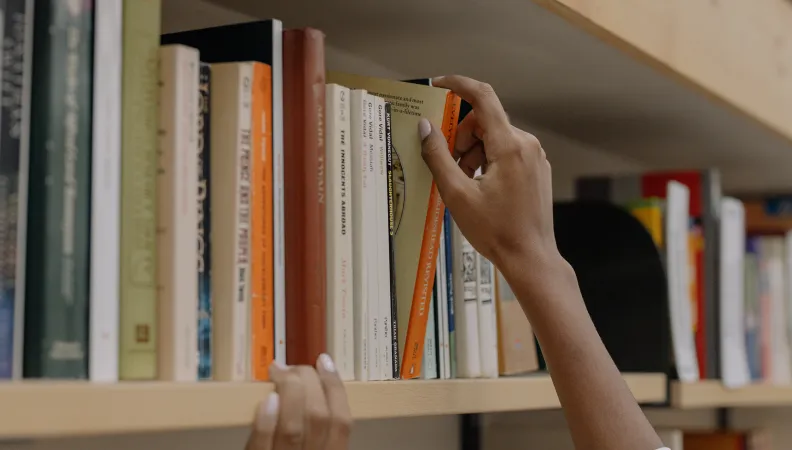 Le projet Sahel Financement Recherche (SAFIRE) s’intéresse aux dynamiques récentes de la recherche dans six pays sahéliens et analyse notamment les effets des financements internationaux, devenus prépondérants, sur les systèmes de recherche de la région. Il vise à éclairer les décideurs sahéliens et les autres acteurs qui interviennent dans le financement de la recherche dans cette zone.
Le projet Sahel Financement Recherche (SAFIRE) s’intéresse aux dynamiques récentes de la recherche dans six pays sahéliens et analyse notamment les effets des financements internationaux, devenus prépondérants, sur les systèmes de recherche de la région. Il vise à éclairer les décideurs sahéliens et les autres acteurs qui interviennent dans le financement de la recherche dans cette zone.
Contexte
Dans un monde complexe et en mutation rapide, une recherche nationale solide et crédible permet de mieux appréhender les défis et enjeux locaux, spécifiques, auxquels les pays (notamment africains) sont confrontés. Dans ce contexte, le projet de recherche SAFIRE s’inscrit dans l’étude des systèmes de recherche et des institutions de connaissances.
Il repose sur l’hypothèse centrale que, après plusieurs décennies de sous-financement et de « désinstitutionalisation » de la recherche africaine, qui a laissé ce secteur exsangue, nous assistons aujourd’hui à une consolidation de la recherche dans les universités africaines, notamment sahéliennes.
Dans le même temps, les financements internationaux (publics et privés) prennent la relève des financements nationaux et jouent un rôle central tant dans l’identification que dans la mise en œuvre des recherches. Le projet SAFIRE s’intéresse donc spécifiquement aux liens entre ces leviers financiers internationaux, dont la croissance récente est massive, et les transformations des systèmes de recherche dans la région.
Objectif
Le projet de recherche SAFIRE visait à analyser les dynamiques récentes de la recherche dans six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad), en se concentrant sur trois domaines de compétences scientifiques : sciences sociales, agriculture et environnement, sciences de la santé.
Le projet SAFIRE a étudié les liens entre, d’une part, les leviers financiers internationaux et les modes de gouvernance de la recherche, et, d’autre part, les transformations à l’œuvre en termes de politiques de recherche, d’institutions, de réseaux – tout en faisant aussi un focus sur les trajectoires individuelles de chercheurs et chercheuses.
Ce projet cherchait à mieux comprendre les interactions entre les ressources individuelles et collectives, les types d’acteurs, leurs stratégies, la mise en place des réseaux et la consolidation des institutions portant la recherche scientifique, notamment dans leur dimension internationale. Les enseignements tirés du projet doivent permettre d’éclairer les décideurs sahéliens et les différentes catégories d’acteurs qui interviennent dans le financement de la recherche dans cette région.
A lire aussi : Repenser le financement international des recherches africaines
Méthode
Le projet s’est déroulé en deux étapes :
- Mesure de la production de recherche dans la région via une analyse bibliométrique
Ce travail a été effectué en collaboration avec l’Université de Leiden, et se fonde sur une analyse des publications répertoriées sur la plateforme Web of Sciences. Cela a permis d’obtenir des informations sur les institutions scientifiques et sur les carrières des chercheurs, et d’appréhender le phénomène des collaborations internationales de recherche ainsi que les effets des financements internationaux.
- Réalisation d’états des lieux des systèmes de recherche dans chacun des six pays sahéliens
Ce travail a été mené par des équipes nationales, sur la base d’analyses documentaires et d’enquêtes qualitatives. L’analyse des politiques nationales d’enseignement supérieur et de recherche a été complétée par celle des paysages institutionnels, approfondie à son tour à travers des monographies d’institutions. Par ailleurs, les entretiens qualitatifs auprès des acteurs locaux ont mis en regard les trajectoires individuelles et celles des institutions et systèmes de recherche.
Résultats
Le projet SAFIRE a permis de réaliser :
- Un panorama de la recherche dans les six pays sahéliens considérés, à travers un examen des politiques et systèmes de recherche, ainsi que des principales institutions scientifiques (académiques et non académiques) ;
- Une analyse comparative entre les six pays sahéliens, mettant en lumière les spécificités de leurs différents systèmes de recherche ;
- Un état des lieux des réseaux et partenariats scientifiques, ainsi que des financement, notamment internationaux ;
- Une meilleure compréhension des trajectoires des chercheurs et chercheuses (personnels appartenant à des institutions de recherche, enseignants universitaires engagés dans des activités de formation et de recherche, individus travaillant dans des laboratoires de R&D privés ou publics indépendants).
Le projet SAFIRE a donné lieu à six rapports pays, ainsi qu’à un rapport régional issu de l’analyse bibliométrique. Trois rapports pays sont accessibles via la plateforme PASAS :
- Chercheurs et politique de recherche au Sénégal : excellence individuelle, faiblesse collective et gouvernance incertaine
- Politiques de recherche et trajectoires des chercheur·e·s et des institutions de recherche au Niger
- Politiques d’enseignement supérieur et de recherche au Tchad
Les autres rapports seront disponibles prochainement.
Enseignements
Il ressort du projet SAFIRE qu’au Sahel, les efforts nationaux en soutien de la recherche restent bien en dessous de l'engagement des Etats d'y consacrer 1% de leur PIB, et celle-ci est en compétition avec l’enseignement supérieur pour l’attribution de ressources financières et humaines. Néanmoins, le nombre de chercheurs et d’institutions sont en hausse.
Les activités de recherche sont très dépendantes des financements étrangers. Certaines disciplines et domaines de recherche comme la santé et l’agronomie, identifiés comme des priorités de développement par la communauté internationale, y ont plus facilement accès et produisent davantage de publications, alors que les sciences humaines et sociales sont moins présentes dans la production de recherche.
La forte hausse des coproductions et des consortiums internationaux indique des changements de fond dans la manière d’organiser la recherche, dont il est toutefois difficile de dire s’il s’agit de nouvelles formes de co-construction partenariale ou de liens de dépendance entre les chercheurs sahéliens et leurs homologues étrangers. Les sciences humaines et sociales semblent en partie échapper à ces transformations.
Enfin, faute d’un cadre adéquat de travail, les chercheurs privilégient des stratégies de carrière liées à la promotion individuelle au sein du système du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), ou se tournent vers les activités de consultance, plus rémunératrices.
Contacts
- Linda Zanfini, chargée de recherche à l'AFD
- Rigas Arvanitis, sociologue, directeur de recherche, IRD/CEPED et Université Paris Cité
 Ce projet de recherche portait sur les dispositifs collectifs d'accès au sol et au logement dans les villes en développement en lien avec les communs. Il a étudié la mise en œuvre de quelques formes collectives d'usage de la terre dans les villes en développement ainsi que leurs effets, notamment en termes d’accès au sol et au logement, de réduction des inégalités urbaines et d'inclusion sociale.
Ce projet de recherche portait sur les dispositifs collectifs d'accès au sol et au logement dans les villes en développement en lien avec les communs. Il a étudié la mise en œuvre de quelques formes collectives d'usage de la terre dans les villes en développement ainsi que leurs effets, notamment en termes d’accès au sol et au logement, de réduction des inégalités urbaines et d'inclusion sociale.
Contexte
Alors que la notion de « communs » fait l’objet d’un regain d’intérêt remarquable dans le monde académique, peu de travaux se sont intéressés à la question du foncier pour l’habitat dans les villes des Suds. L’accès au sol urbain est pourtant un enjeu majeur pour les citadins de ces villes en pleine croissance, déterminant pour l’amélioration des conditions de vie quotidiennes et pour l’accès à un « logement convenable », selon la terminologie onusienne. L’approche dominante en matière de foncier urbain, orientée vers la pleine propriété privée et le marché libre, génère accaparement spéculatif et exclusion des ménages les plus précaires. La force critique de la notion de communs ouvre des voies innovantes pour produire de l’habitat dans les Suds, selon des perspectives plurielles et attentives aux besoins et pouvoir d’agir des habitants.
Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre du programme de recherche de l'AFD sur les communs.
Objectif
Ce projet de recherche a permis d’analyser la diversité des communs, hybrides, perméables, évolutifs – dans l’espace et dans le temps – orientés vers l’obtention et la sécurisation de droits d’accès au foncier et à l’habitat et aux services associés, qui naissent bien souvent d’opportunités spécifiques. Il s’est penché sur les manières originales de détenir le foncier en commun, pour une fonction d’habitat et dans une perspective non-spéculative (quand le transfert du foncier s’effectue selon un encadrement décidé au préalable par le collectif, sans plus-value).
Méthode
La méthodologie reposait sur des études de cas dans les villes en développement :
- La première phase de l'étude (2017-2018) a permis de réaliser trois enquêtes de terrain au Burkina Faso, au Kenya et en Inde.
- La seconde phase (2018-2020) était constituée de deux terrains supplémentaires (Brésil, Mexique) ainsi que du suivi des travaux menés en Nouvelle-Calédonie par des étudiants dans le cadre de l’Ecole des Affaires urbaines (mastère « cycle d’urbanisme ») de Sciences Po Paris.
L'équipe était composée d’un universitaire habilité à diriger les recherches (HDR), qui a assuré la direction et l'exécution de l'étude, d’un ingénieur de recherche, qui a assuré la coordination scientifique de l'étude, de chercheurs locaux spécialistes des questions foncières et urbaines dans les pays d'enquêtes.
Le travail a été réparti en cinq phases : recherche documentaire, recherche terrain, traitement des données, rédaction des livrables, valorisation des résultats.
Résultats
Ce projet de recherche a donné lieu à la publication de plusieurs papiers de recherche aux Editions Agence française de développement :
- « Communs fonciers pour des villes inclusives » : ce papier de recherche présente les principaux enseignements de 8 cas d’étude de sécurisation de l’habitat populaire par la propriété partagée du sol.
- « Le sol social mexicain porte-t-il encore des communs ? » : les communs fonciers mexicains subissent des transformations majeures depuis les années 1990. Ce papier de recherche présente les travaux par les étudiants du Cycle d’urbanisme de Sciences Po Paris, encadrés par Jean-François Valette, sur la périphérie de la zone métropolitaine de Mexico.
- « Régulariser les favelas de Rio grâce à la mise en commun des terres ? » : lumière sur un dispositif original de régularisation foncière collective dans les quartiers précaires, qui met en oeuvre la notion de propriété plurielle parcourant le droit brésilien, et qui défend le droit des habitants à rester sur place.
- « Les coopératives d’usagers en Uruguay : le défi de l’habitat comme commun » (en espagnol)
Le rapport final du programme de recherche sur les communs fonciers pour l’habitat dans les Suds est téléchargeable en cliquant ici.
L’ensemble des publications et des événements liés au projet sont recensés sur le site suivant : Communs fonciers pour l’habitat – Quelle contribution à l’inclusion urbaine dans les Suds ? (hypotheses.org)
Enseignements
« Les communs peuvent s’entendre comme une politique sociale de l’habitat, en proposant un accès au logement aux catégories sociales les plus vulnérables. En outre, ils peuvent constituer une alternative aux politiques publiques de logement plus classiques tournées vers l’accès à la propriété privée individuelle. Si ces initiatives résultent de collectifs d’habitants organisés, elles sont parfois encadrées par les gouvernements nationaux. Souvent acceptés, encouragés voire érigés en modèles à suivre, les communs font l’objet d’une attention accrue ces dernières années par des fédérations d’habitants, des associations, ONG et institutions internationales qui documentent leur fonctionnement et contribuent à la circulation internationale de ces idées alternatives. » (Simonneau et Denis, 2021)
A lire sur The Conversation : Le partage de la terre est-il encore un enjeu en Nouvelle-Calédonie ?
Contacts :
- Claire Simonneau, enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel et chercheuse au laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS)
- Stéphanie Leyronas, chargée de recherche à l'AFD
 L’éducation arabo-islamique (EDUAI) au Sahel reste encore méconnue, bien qu’elle fasse partie des éléments essentiels à prendre en considération pour comprendre et gouverner les systèmes éducatifs de la région. Ce projet de recherche, confié à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), vise à améliorer les connaissances sur cette offre éducative, ses publics et sa prise en compte par les politiques publiques, afin d’informer l’action des décideurs de la région sahélienne.
L’éducation arabo-islamique (EDUAI) au Sahel reste encore méconnue, bien qu’elle fasse partie des éléments essentiels à prendre en considération pour comprendre et gouverner les systèmes éducatifs de la région. Ce projet de recherche, confié à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), vise à améliorer les connaissances sur cette offre éducative, ses publics et sa prise en compte par les politiques publiques, afin d’informer l’action des décideurs de la région sahélienne.
Contexte
Si des progrès importants en matière d’accès à l’éducation ont été observés depuis les années 2000 au Sahel, des défis importants restent à relever en termes d’accès, de qualité de l’enseignement ou encore de réduction des inégalités (entre filles et garçons, entre milieu urbain et rural…).
Dans ce contexte, de nombreux enfants en âge scolaire sont pris en charge par une offre éducative adossée à la religion musulmane, généralement arabophone. Très ancrée dans de nombreuses sociétés, cette offre dite « arabo-islamique » est multiforme : elle couvre un continuum qui va d’unités familiales très informelles et aux contenus exclusivement confessionnels, à des établissements formels plus ou moins intégrés à l’offre publique, en passant par des formes intermédiaires, et évolutives dans le temps. Il s'agit d'un système éducatif largement répandu, et d'une réalité qui ne peut pas être ignorée dans l’élaboration des politiques publiques locales.
A lire sur The Conversation
Objectif
La finalité de cette étude est de contribuer à la production de connaissances actualisées et pertinentes sur l’éducation arabo-islamique au Sahel, phénomène complexe, très ancré et diffus dans les sociétés sahéliennes mais qui reste un angle mort de la recherche et des politiques publiques. Ce projet a aussi pour objectif d’informer les décideurs des pays sahéliens et les différents bailleurs sur ce phénomène, en vue de les doter de clés de lecture nécessaires à la conduite de politiques publiques.
En effet, la connaissance de l’éducation arabo-islamique sous ses différentes formes est une condition préalable à toute intervention, qu’il s’agisse d’encadrer les pratiques jugées les plus discutables, de favoriser la prise en compte de cette offre dans les politiques d’éducation et de formation professionnelle ou d’appuyer une offre éducative qui peut s’avérer particulièrement pertinente en situation de crise, notamment sécuritaire.
Méthode
Première recherche d’envergure sur l’éducation arabo-islamique à l’échelle des six pays sahéliens, le projet EDUAI a été conduit par une équipe pluridisciplinaire et plurinationale, coordonnée par le Dr Hamidou Dia de l’IRD.
Ce projet a pris appui sur des inventaires extensifs (inventaire des recherches, de la littérature grise, des structures et institutions, des données quantitatives et de la presse), ainsi que sur des enquêtes de terrains et des entretiens auprès des différentes catégories d’acteurs de l’EDUAI. Plusieurs ateliers de recherche et moments d’échange avec les parties prenantes ont permis de mettre en débat les résultats et d’alimenter l’élaboration des rapports pays et de la synthèse, rédigés suivant un canevas commun afin de faire émerger les éventuelles analogies, voire d’identifier les phénomènes de portée transnationale ou régionale.
Résultats
L’étude confirme le dynamisme de l’éducation arabo-islamique au Sahel, qui se manifeste notamment par un renouvellement des publics. On observe ainsi une féminisation des écoliers – au Tchad et au Niger, plus de 50% des élèves sont des filles –, et la présence accrue des classes moyennes. La réémergence des universités arabo-islamiques dans certains pays (notamment au Niger et au Mali) montre aussi ce dynamisme.
L’étude souligne la diversité des ressources finançant l’EDUAI, qui varient largement d’un pays mais aussi d’une école à l’autre. Selon le contexte, l’importance des ressources provenant de l’étranger donne un poids important aux acteurs et aux dynamiques étrangères dans l’évolution de l’EDUAI.
L’étude montre aussi que le positionnement de cette offre vis-à-vis de l’État varie en fonction des acteurs, courants, modes d’intervention et modes de financement. Selon les types d’offre, les milieux de résidence ou les profils des élèves, l’éducation arabo-islamique peut être complémentaire de l’éducation classique ou s’y substituer, ce qui est le cas notamment dans les régions où les services publics sont déstabilisés.
Vous trouverez ci-dessous les différents papiers de recherche liés à ce programme de recherche :
- Rapport de synthèse du projet Education arabo-islamique au Sahel
- Etat des lieux de l'EDUAI au Niger
- Etat des lieux de l'EDUAI au Sénégal
- Etat des lieux de l'EDUAI au Tchad
- Etat des lieux de l'EDUAI en Mauritanie
- Etat des lieux de l'EDUAI au Burkina Faso
- Etat des lieux de l’EDUAI au Mali
- « Les institutions d’éducation islamique au Sahel : entre développement communautaire privé et desseins hégémoniques des systèmes scolaires étatiques »
Un webinaire de la série Conversations de recherche a été organisé en septembre 2022 et peut être revisionné en replay (ci-dessous).
Enseignements
Cette étude confirme l’existence d’une offre éducative plurielle et évolutive, avec l’émergence, au cours des dernières décennies, de nouveaux formats, poussant parfois vers une modernisation de l’éducation, parfois vers un retour aux traditions, avec des tensions entre les acteurs de l’EDUAI et/ou des divisions intra-nationales importantes autour des questions religieuse et linguistique.
Le positionnement de cette offre vis-à-vis de l’Etat et des institutions varie en fonction des acteurs, courants, modes d’intervention et modes de financement. Dans certains pays, les tentatives de réformes par l’Etat ont fini par cristalliser les tensions et entériner la dualité du système. Néanmoins, l’essor et le dynamisme de cette offre éducative dans la région plaident pour que l’on explore plus en profondeur les possibilités d’établir des passerelles avec l’enseignement séculier.
Mettant en lumière la diversité de cette offre éducative et des acteurs qui la portent, le projet permet d’en améliorer la compréhension et de guider la prise de décision de l’AFD, de ses partenaires sahéliens ou des bailleurs, à un moment où l’EDUAI devient pour eux un champ d’intervention à part entière.
Contacts
- Dr Hamidou Dia, socio-anthropologue, chargé de recherche à l'IRD
- Linda Zanfini, chargée de recherche à l'AFD